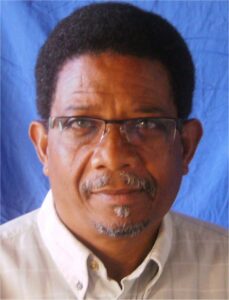
Le mariage : contrat juridique ou spirituel?
Le mariage est le lieu du don de soi. Lorsque deux êtres s’y engagent, c’est généralement avec l’intention de s’unir pour la vie. Il s’agit d’un véritable acte de foi — foi en l’autre, et pour beaucoup, foi en Dieu — avec l’espoir profond d’y trouver le bonheur. De cette confiance mutuelle naît une dimension spirituelle essentielle à l’épanouissement du couple.
Mais lorsque survient une trahison, c’est bien plus qu’un simple manquement à un engagement : une blessure profonde est infligée, souvent difficile à cicatriser. Le conjoint lésé se retrouve alors en quête de sens et de soulagement face à cette douleur émotionnelle. Pourtant, les réponses proposées par le droit ne s’intéressent qu’à l’aspect contractuel : la réparation se limite à une compensation financière ou civile du préjudice subi.
Or, ces réparations juridiques ne peuvent suffire à à apaiser la souffrance morale. Cela tient au fait qu’au-delà du contrat civil, il existait un autre engagement, plus intime, plus silencieux : un contrat d’amour. Celui-ci repose sur un investissement affectif et spirituel que ni le droit ni les institutions ne peuvent véritablement mesurer, encore moins restaurer.
La Bible : référentiel des valeurs spirituelles pour le mariage
Nombreux sont les spécialistes qui se sont penchés sur la place de la spiritualité dans la vie humaine. Aujourd’hui, il est largement reconnu qu’elle constitue un besoin fondamental, figurant même parmi les niveaux supérieurs de la pyramide des besoins.
Si l’on revient à la première alliance entre un homme et une femme selon le récit biblique — celle d’Adam et Ève — un fait remarquable se distingue, propre à ce texte fondateur. En découvrant Ève, Adam s’exclame :
« Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair ! »
Ce « cette fois » n’est pas anodin. Il suggère qu’Adam, après avoir observé tous les animaux du jardin d’Éden, n’aurait trouvé en aucun d’eux un être capable de répondre aux aspirations profondes de son âme. Dieu choisit alors de créer une femme à partir d’Adam lui-même — non pas de la poussière, comme pour l’homme, mais « en lui retirant une côte ». Cette représentation n’est pas fortuite : elle accentue la ressemblance, l’intimité, la proximité. Car même en présence de Dieu, l’homme ressentait une solitude que seule une communion humaine, émotionnelle et complémentaire pouvait combler.
Ce premier couple exprime ainsi l’un des fondements du lien conjugal voulu par Dieu :
« J’ai trouvé celle qui me ressemble et me comprend. »
Autrement dit, celle qui peut entendre et répondre à mes besoins émotionnels les plus profonds.
L’homme, comme la femme, porte en lui ce besoin d’épanouissement émotionnel et spirituel dans un cadre sécurisant. Ce besoin dépasse le simple cadre matériel ou charnel. Jésus lui-même l’illustre en affirmant :
« L’homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »
Cette parole réaffirme que l’être humain, dans sa globalité, a besoin de se nourrir d’une dimension spirituelle pour s’accomplir pleinement — et cela vaut tout particulièrement dans l’alliance conjugale.












